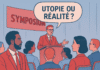J’ai toujours aimé réfléchir et théoriser le cinéma. C’est tellement plus que du simple divertissement. C’est une fenêtre ouverte sur le monde, nos sociétés, qui nous amène parfois à les repenser. Les films nous apprennent qui nous sommes, si l’on se donne la peine de les regarder, de les écouter. Longtemps, je me suis demandé si je n’étais pas « devenue » lesbienne par la faute du cinéma… ou plutôt, grâce au cinéma !
Scène 1. Légendes d’automne
Comme tout le monde, lorsque j’étais jeune, à l’époque de Légendes d’automne (1994), j’avais une affiche de Brad Pitt dans ma chambre. Au contraire de tout le monde, quand je regardais son image, je ne ressentais rien. Il était beau, plutôt bon acteur, pis après ?
Scène 2. Dawson’s Creek
Comme tous les ados de mon âge, ou presque, je regardais la série Dawson’s Creek. Ce n’est rien contre l’acteur James Van Der Beek, qui joue Dawson, un adolescent qui se passionne pour le cinéma, mais je ne le trouvais pas beau. En revanche, comme Dawson, j’avais le béguin pour Joey Potter (Katie Holmes), the girl next door, le « garçon manqué »… (Si c’est ça être un garçon manqué, j’aurais préféré en être…) Enfin, comme Dawson, je voulais étudier le cinéma et « être amie » avec Joey, tourner des films avec elle, lui ressembler…
Scène 3. Titanic
Comme tout le monde, en 1997, je suis allée au cinéma voir Titanic, le film à succès de James Cameron. Oui, Leonardo DiCaprio est beau et bon acteur, mais que dire de Kate Winslet ? De cette scène où elle se dévêt pour devenir le modèle nu, voire l’objet du regard de Leo ? Non sans une certaine honte, je n’avais pas osé avouer à quiconque que je regardais plus Kate que Leo… quoique, la mise en scène dirigeait — forçait — mon regard ! Elle était nue, l’objet du regard, de désir… manifestement érotisée. Tout portait à la regarder, elle. Inconsciemment, ou par l’art conscient et calculé de la mise en scène, est-ce que le cinéma était en train d’orienter mes désirs ?
Scène 4. L’Ange Bleu, Morocco et Shanghai Express
Lors de mes études en cinéma, je suis tombée en amour avec Marlène Dietrich, « l’ange bleu »… Dans Morocco (1930, Joseph von Sternberg), elle se joue des codes genrés ; alors vêtue d’un pantalon et d’un chapeau, la chanteuse de cabaret Amy Jolly (Dietrich) embrasse une autre femme. Wow ! En « performance » sur scène, le regard du spectateur renforce l’identification… (Un peu comme Marilyn Monroe ; les femmes veulent lui ressembler, les hommes veulent la baiser.) Si Dietrich était la muse du réalisateur Joseph von Sternberg, ce dernier viendrait créer la star. La jeune Allemande sera vêtue pour attirer l’attention du public, exacerber la fascination. Sans compter la magie du cinéma ; cette scène notoire de Shanghai Express (1932) dans le train, avec une lumière venue des cieux, éclairant le visage de Marlène, telle une icône, à en faire rougir de jalousie la vierge Marie.
Scène 5. Prises multiples. Théorisations diverses.
Au fil du temps, j’ai compris que le regard au cinéma était une construction. Une construction qui passe par les codes cinématographiques. Des codes régis et appliqués par ceux qui font le cinéma, le produisent, le financent. Ceux qui écrivent et réalisent les films. Les hommes. Longtemps majoritaires, bien que ce soit appelé à changer dans le Québec récent (et on s’en félicite) ! Le médium cinématographique, à l’image de la société dans laquelle il prend naissance, est un produit du patriarcat. Bref, le cinéma est une construction, majoritairement un produit du regard des hommes. C’est pour cette raison que, la plupart du temps, la femme se retrouve objet, du désir, du regard, de l’homme.
Lors de mes études, je me souviens avoir étudié les théories de la réalisatrice britannique féministe Laura Mulvey à l’origine du concept du « regard masculin » (male gaze). À l’ère des bombardements sociomédiatiques et des notions de consentement, cette théorie du regard masculin vous semble peut-être flagrante. Certes, lors de sa publication en 1975 dans Screen, « Visual Pleasure and Narrative Cinema » sera un article fondateur des études féministes sur le cinéma. En se référant à l’idée freudienne du phallocentrisme, Mulvey donne maints exemples du cinéma classique hollywoodien, d’Hitchcock à von Sternberg, pour illustrer comment les composantes filmiques (images, personnages, histoires, dialogues, etc.) sont construites sur l’inconscient de la société patriarcale. Ainsi, visionner un film reproduit inconsciemment, ou à peu près consciemment, les rôles sociétaux hétéronormatifs typiques des hommes et des femmes, explique Mulvey. Regarder est généralement considéré comme un rôle masculin actif, alors que le rôle passif d’être regardé est immédiatement perçu comme une caractéristique féminine. Laura Mulvey soutient que les femmes dans le cinéma sont liées au désir et que les personnages féminins ont une apparence codée pour avoir un fort impact visuel et érotique. Le rôle premier de l’actrice féminine n’est pas censé représenter un personnage qui affecte directement l’issue d’une intrigue, bien que sa présence soit indispensable comme élément de spectacle dans les films narratifs classiques ; elle est « insérée » dans le film pour être objectivée sexuellement, « pour figer le flux de l’action dans les moments de contemplations érotiques » (1).
Si Laura Mulvey réalise des documentaires d’avant-garde venant contrer cette vision patriarcale de l’industrie hollywoodienne (comme nombre de films indépendants), aux antipodes des canons de l’industrie, leur diffusion sera toutefois limitée. Ainsi, vous n’avez probablement jamais vu Penthesilea: Queen of the Amazons (1974), ou Frida Kahlo & Tina Modotti (1983). Revenons à la théorie de Mulvey, selon laquelle les personnages féminins sont « codés » de façon érotique pour plaire, fasciner, susciter le désir (chez l’homme) et favoriser l’identification (chez la femme)… Dans mon cas, tous ces films vus, avec des personnages féminins créés pour susciter le désir et la fascination, n’auraient-ils pas participé, « inconsciemment », à forger mon lesbianisme ?
Scène 6. The L Word
Comme toutes les lesbiennes de mon âge, j’ai vu The L Word. J’ai été ravie de voir cette série à l’époque où trop peu de représentations lesbiennes au petit (et grand) écran étaient visibles. Des décennies plus tard, sans le recul nécessaire, il est facile de « critiquer » de telles représentations, mais il n’en demeure pas moins qu’elles font partie d’un cheminement inévitable à toutes minorités. Faire accepter des réalités marginales passe d’abord par les clichés. Ce n’est pas nouveau. C’est l’histoire des arts, des médias, des représentations sociales… Tout ça pour dire qu’en 2004, ma blonde et moi avons dévoré cette série. Voir à la télé des couples lesbiens, comme nous, même si elles étaient plus riches, plus belles et sous le soleil de L.A., c’était nouveau et rafraîchissant ! On avait l’impression d’exister. La télé venait légitimer notre existence.
Scène 7. La vie d’Adèle
Près d’une décennie plus tard, en 2013, j’ai vu La vie d’Adèle. C’était lors d’une projection de presse. Dans la salle, quelques journalistes, une majorité d’hommes. J’ai trouvé que la scène d’amour faisait un peu trop pornographique (c.-à-d. fantasme d’un réalisateur mâle hétéro, Abdellatif Kechiche). Sinon, pour le reste du film, j’ai pleuré ma vie. Perso, ça n’allait pas avec ma blonde, j’avais ma boîte de Kleenex pas loin : « Cinéma, cinéma, j’veux mourir, viens dans mes bras »… Je me suis dit, encore une fois, que le cinéma était là pour me réconforter, me répondre. « Miroir, miroir, dis-moi… »
Scène 8. Les aventures de Chatran — FLASHBACK
Terminons avec le premier film que j’ai vu au cinéma. J’avais 6 ans. Mes parents m’avaient emmenée voir Les Aventures de Chatran (1986, Masanori Hata), un film d’aventure japonais qui raconte l’histoire d’un chaton roux qui se retrouve abandonné, par accident, à la campagne. Il traverse régions et saisons, accompagné de son ami chien, et fait la rencontre de nombreuses espèces animales. J’étais en amour avec ce beau petit chaton roux. Je rêvais d’en avoir un… Mon souhait fut exaucé : un an plus tard, j’en avais un identique. C’était Chatran ! N’est-ce pas ce qu’on peut appeler la magie du cinéma ?
Sinon, en date d’aujourd’hui, j’ai encore un gros crush sur Katie Holmes…
1. Laura Mulvey. « Visual Pleasure and Narrative Cinema », dans Constance Penley (Ed.) Feminism & Film Theory, New York : Routledge, 1988, 57-68.