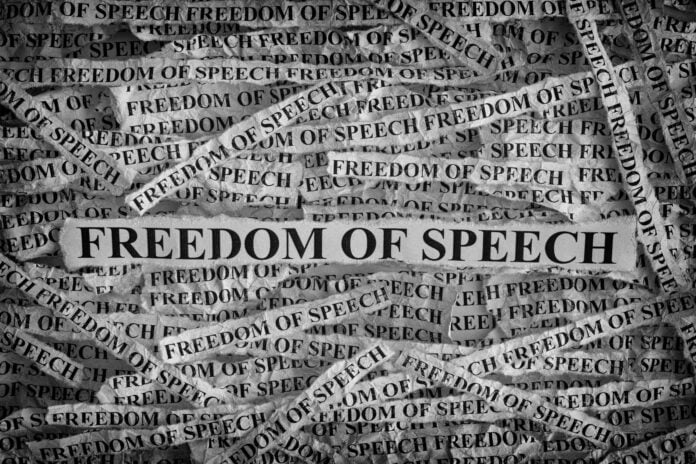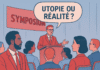Les États-Unis se définissent depuis plus de deux siècles comme la « terre de la liberté », comme le proclame l’hymne national. Pourtant, à voir l’évolution récente du pays, cette liberté semble s’effriter dès qu’il s’agit de contredire Donald Trump. De quoi poser une question qui revient de plus en plus souvent : la liberté d’expression est-elle en train de mourir dans les États-Unis d’Amérique?
Un droit fondamental au cœur de l’identité américaine
La liberté d’expression, garantie par le Premier amendement, fait partie des valeurs les plus chéries des Américains. Ratifié le 15 décembre 1791, il stipule : « Le Congrès ne fera aucune loi ayant pour objet l’établissement d’une religion, ou en interdisant le libre exercice; ni restreignant la liberté de parole, ou de la presse; ni le droit du peuple de se réunir pacifiquement, et d’adresser au gouvernement des pétitions pour la réparation de torts subis. »
Ce droit occupe une telle place dans la culture américaine qu’à l’approche de l’élection présidentielle de 2024, il figurait parmi les préoccupations principales des électeurs, devant des enjeux comme la criminalité, l’immigration ou la politique des armes à feu.
Lors de son investiture, le 20 janvier, Donald Trump a juré de « mettre fin immédiatement à la censure gouvernementale et de ramener la liberté d’expression en Amérique », accusant Joe Biden de l’avoir étouffée. Le même jour, il a signé un décret intitulé Restaurer la liberté d’expression et mettre fin à la censure fédérale.
Trump affirmait que l’administration démocrate avait exercé une « pression coercitive » sur les médias sociaux et d’autres organisations pour supprimer ou modérer les contenus qui ne correspondaient pas à la ligne officielle, sous prétexte de lutter contre la désinformation. Dans sa logique, la suppression de théories conspirationnistes liées à la COVID-19 ou aux élections constituait une atteinte directe aux droits constitutionnels.
Il faut rappeler que ses propres comptes sur les réseaux sociaux avaient été suspendus en janvier 2021 après l’assaut du Capitole, pour avoir encouragé ses partisans qu’il avait qualifiés de «patriotes». Depuis, Trump et son entourage dénoncent une prétendue clique organisée gauchiste (évidemment des extrémistes à ses yeux) visant à museler la pensée conservatrice au nom de l’idéologie « woke ».
Du discours à la censure, neuf mois plus tard
Neuf mois après avoir promis une liberté d’expression sans limites, Trump et ses alliés semblent avoir oublié leurs grands principes. L’assassinat de Charlie Kirk, figure de la droite dure et proche du président, a marqué un tournant.
Kirk a été tué par balle alors qu’il participait à un débat public à l’Université de l’Utah. Son décès a ému profondément les milieux conservateurs, qui le présentent désormais comme un martyr. Des veillées ont eu lieu partout aux États-Unis, tandis que certains commentateurs de gauche etbde centre rappelaient que Kirk avait bâti sa carrière sur la désinformation, la transphobie et l’hostilité aux droits des minorités.
En réaction, la droite a exigé de museler toute critique. Des personnalités de l’administration Trump ont publiquement appelé à surveiller, sanctionner, voire congédier toute personne — civils, employés, militaires ou étrangers — qui se permettait de dénoncer Kirk ou de se réjouir de sa mort. Plusieurs dizaines d’Américains ont déjà perdu leur emploi à la suite de commentaires jugés inacceptables.
Trump lui-même s’en est pris aux humoristes Jimmy Kimmel, Seth Meyers et Jimmy Fallon. Sous pression politique, l’émission de Kimmel a été retirée des ondes, et le président a publiquement encouragé NBC à en faire autant avec les autres animateurs, qualifiés de « losers ».
Une liberté à deux vitesses
Le contraste est frappant. Après avoir accusé Biden de censure, Trump et son administration orchestrent aujourd’hui une véritable campagne de musèlement contre leurs adversaires politiques, journalistes et artistes compris. La vice-présidence, le Département de la Défense et le Département d’État multiplient les menaces de sanctions, allant jusqu’à évoquer le retrait de visas à des étrangers critiques de Kirk.
La contradiction est telle que même des experts en droit constitutionnel sonnent l’alarme. Pour Erwin Chemerinsky, doyen de la faculté de droit de l’Université de Californie à Berkeley, Trump veut « utiliser les outils de l’État pour réduire au silence les voix qui lui déplaisent », un précédent inédit dans l’histoire américaine.
De l’ironie à l’hypocrisie
Il y a une ironie amère dans cette croisade. Charlie Kirk lui-même défendait avec ferveur l’absolutisme du Premier amendement. Selon lui, il n’existait pas de « discours haineux » en droit américain : même les propos « laids, immondes ou abjects » étaient protégés.
Aujourd’hui, son nom est invoqué pour justifier la censure de celles et ceux qui ne partagent pas la vision républicaine du monde. Trump ne cherche pas à protéger la liberté d’expression, mais à imposer une liberté à géométrie variable : celle qui favorise sa propre parole et celle de ses alliés, au détriment de toute pensée critique.
Comme l’a résumé un éditorialiste de USA Today : « Trump ne veut pas la liberté d’expression. Il veut une liberté de faveur. Pour lui-même. Et il utilise le gouvernement, et maintenant la mort de Kirk, pour y parvenir. »