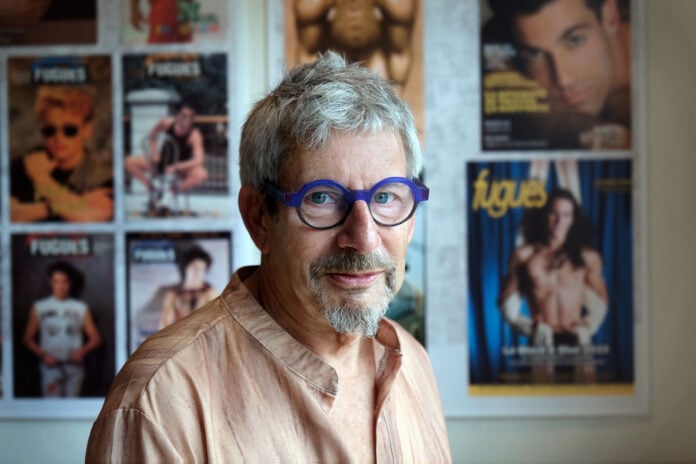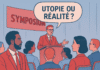La pièce Corps fantômes, au Théâtre Duceppe, remet en lumière l’histoire récente de nos communautés. On ne peut que s’en réjouir. Mais on met aussi en lumière le manque de transmission de cette histoire pour les plus jeunes et la nécessité de préserver ce passé, et même de partir à sa recherche.
Des chercheur·e·s se passionnent aujourd’hui pour sortir de la poussière de l’oubli des personnes qui, au cours des siècles, ont façonné l’histoire des personnes LGBTQ et que les sociétés et les institutions ont jetées aux oubliettes. Des associations aussi, et l’on pense tout de suite aux Archives gaies du Québec ou aux Archives lesbiennes, qui se consacrent à la préservation de cette histoire, à la rendre visible par des expositions.
Il ne faut évidemment pas généraliser non plus sur les jeunes. J’en connais beaucoup qui sont très sensibles (et curieux) à ce que les générations précédentes ont fait. Comme je connais des aîné·e·s qui ont vécu sans même se rendre compte ni s’intéresser aux luttes qui se menaient à leur époque. Comme ce gai, de mon âge, qui me demandait pourquoi il y avait une manifestation un 1er décembre et qui s’arrêtait devant le Parc de l’Espoir. Lui ayant gentiment répondu — ce qui est rare chez moi — il hocha la tête avec une moue appréciative et un regard étonné. Comme si le sida lui passait tout à fait au-dessus de la tête (vous auriez dû voir mon regard étonné).
On ne peut donc que se féliciter de voir se multiplier des initiatives comme celles de Corps fantômes et de l’engagement de l’équipe du Théâtre Jean-Duceppe, organisant deux expositions illustrant les luttes passées et plus précisément celles des années 1990.
On parle de lutte, de militantisme, de résistance, d’occupation de l’espace public. Une façon de dire que nous existions et que nous ne nous laisserions plus marcher sur les pieds : une sortie du placard, mais cette fois-ci collective.
Bien sûr, pour beaucoup, ceci appartient au passé. Et, devant les gains que nos communautés ont pu obtenir, aussi bien socialement que juridiquement, on peut tranquillement retourner chez soi et passer à autre chose. De toute façon, des organismes s’occupent de propager la bonne parole, ils éduquent, ils sensibilisent. Ils sont les bienvenus dans toutes les officines gouvernementales, servent de courroie de transmission entre les décideurs et décideuses et le terrain.
On ne parle plus beaucoup de militantisme aujourd’hui. Peut-être le mot est-il trop lourd de connotations. On parle de concertation, de rencontres, etc. On pourrait presque voir la vie en rose.
Sauf que…
En 2023, Statistique Canada dévoilait qu’entre 2020 et 2022, les crimes haineux envers les personnes 2SLGBTQ+ avaient augmenté de 64 %, et atteignaient 69 % en 2023. L’homophobie et la transphobie ne sont pas en régression, mais en augmentation. L’organisme GRIS Montréal, dont la mission est la démystification de la diversité sexuelle et de genre en milieu scolaire, constate de son côté, à partir des évaluations faites après chacune de leurs interventions, un accroissement de la perception négative des personnes 2SLGBTQ+ chez les jeunes que l’organisme « sensibilise ». Un brin inquiétant.
Et si l’on s’éloigne du Québec et du Canada, on ne peut que s’alarmer du recul des droits et de la sécurité des personnes de la diversité à travers le monde.
Pour faire face à ce phénomène de retour de bâton, il est peut-être nécessaire de savoir d’où l’on vient, quels sont les écueils qu’ont dû surmonter celles et ceux qui nous ont précédés, et de se rappeler que rien n’est jamais acquis.
La pièce Corps fantômes prend alors tout son sens. Bien loin d’une simple illustration d’une époque lointaine et révolue, elle sonne comme un rappel à rester éveillé et vigilant.