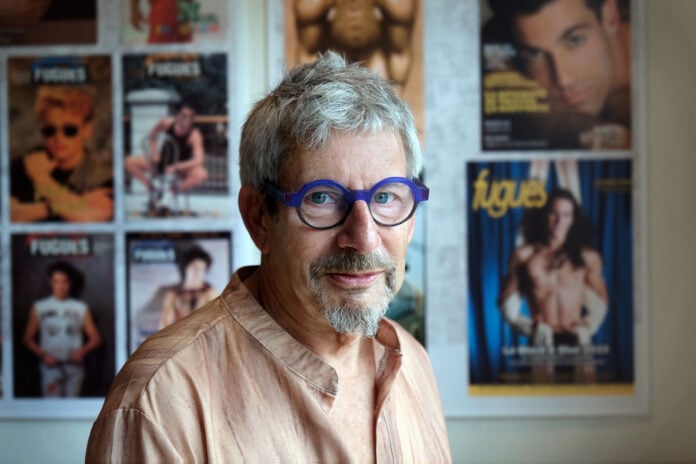La dizaine de jours censés célébrer la fierté de la diversité des genres et des orientations sexuelles a offert cette année un spectacle pour le moins désaccordé. Plus qu’un concert cacophonique : un joli capharnaüm où la confusion régnait, où les annonces contradictoires, les défections d’organismes et les hésitations à peine voilées ont alimenté un sentiment de chaos. Chacun, chacune, devait choisir entre le défilé « officiel » de Fierté Montréal, la marche de la Fierté indomptable, ou encore l’option de rester chez soi, perplexe, à se demander ce que tout cela voulait dire.
Le feu couvait déjà depuis l’an dernier. Certains groupes queer avaient attiré l’attention en dénonçant la présence de collectifs juifs au défilé, au nom de l’intersectionnalité et de la solidarité avec la Palestine. Bien évidemment, personne ne s’imagine défendre le gouvernement israélien ni son offensive sanglante à Gaza. Dénoncer les exactions de Netanyahou n’est pas une mauvaise chose en soi ; militer pour un État palestinien relève d’une légitime revendication de justice. Rappeler que nos
communautés LGBTQ+ ne restent pas indifférentes à ce drame international était une idée noble. Encore faut-il que ce désir d’élargir nos horizons géopolitiques se conjugue avec la même énergie lorsqu’il s’agit de dénoncer d’autres régimes — arabes, africains, asiatiques ou occidentaux — qui piétinent les droits des femmes, des personnes queer et trans, au nom d’une religion, d’un nationalisme ou de purs intérêts économiques. Car si le cri pour Gaza résonne haut et fort, il faudrait que la même indignation s’élève contre l’Ouganda, la Russie, la Hongrie, l’Arabie saoudite ou tout autre État où la haine des minorités sexuelles et de genre demeure un instrument politique. Autrement, on risque de donner l’impression d’une indignation sélective, ou pire, d’une instrumentalisation des luttes LGBTQ+. Oui, un bilan doit être fait.
Mais pas sur la place publique, en cherchant des coupables faciles. Les hésitations de Fierté Montréal — exclure puis réintégrer les groupes juifs — ne peuvent pas être interprétées comme une caution tacite des massacres à Gaza. L’affaire était certes mal gérée, confuse, mais y voir un silence complice est injuste. Les véritables responsables des drames humains se trouvent ailleurs : du côté des dirigeants politiques, pas des organisateurs d’un défilé queer. Il n’en demeure pas moins que nos communautés sortent de cette Fierté divisées, abîmées, parfois perdues. L’exclusion, puis le volte-face, ont ébranlé la confiance. Et la décision du Conseil québécois LGBTQ+ d’appuyer la marche des Indomptables à la place de Fierté Montréal, prise à la hâte quelques jours avant le défilé, a ajouté à la confusion. Avec pour résultat un patchwork où, parmi les 80 organismes membres du Conseil, chacun a choisi son camp : défiler avec les uns, avec les autres, participer à une journée communautaire ou les deux, ou carrément s’abstenir.
Ce n’est ni la première ni la dernière crise que nous traversons au sein de nos communautés, mais peut-être serait-il temps d’appuyer sur pause et de faire collectivement le point. Une question s’impose : quel est aujourd’hui le rôle du Conseil québécois LGBTQ+ ? Officiellement, il est un interlocuteur privilégié des gouvernements. Mais quel est son véritable poids politique ? À quelles voix donne-t-il réellement écho ? Aux voix locales ou aux enjeux internationaux ou intersectionnels non liés directement aux communautés LGBTQ+? La question mérite d’être posée, On se rappellera la crise vécue par Interligne en 2023, lorsqu’un organisme même du Conseil et vital pour nos communautés a subi de lourdes coupures budgétaires. Le Conseil a bien soufflé un faible « ce n’est pas bien », sans jamais hausser le ton ni tenter de mobiliser collectivement. Résultat : Interligne s’est battu seul. Scénario semblable avec le fameux Comité de sages, mis en place par Québec pour réfléchir à la façon d’encadrer et d’aider les personnes non-binaires et en transition — un comité sans aucune personne trans à sa table. Le Conseil s’est contenté de rappeler qu’il serait consulté, comme si cette promesse suffisait à légitimer le Comité. Quelques mois plus tard, avant la diffusion du fameux rapport du Comité des sages, on en a finalement dénoncé la teneur, les aprioris contestables, les conclusions qui allaient venir, mais il était trop tard : les dés étaient jetés, et la contestation sonnait creux.
On me répète souvent que le Conseil entretient de bonnes relations avec les ministres et que ce dialogue est important pour influencer les politiques qui touchent les communautés LGBTQ+. Soit. Mais à force de ménager les élus, on sacrifie aussi un peu de l’essence militante de nos luttes ? La frilosité du Conseil ne tient-elle pas au fait qu’une partie du financement des organismes dépend directement du Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie ? Comment hausser le ton quand on craint pour les budgets de fonctionnement ? Les petits organismes, eux, n’ont pas ce dilemme. Moins financés, moins visibles, ils n’ont rien à perdre et tout à gagner à adopter des postures militantes plus radicales. Mais voilà : ce sont souvent les grands organismes, mieux établis, qui dominent la conversation. Et l’impression de certain.es grandit que la solidarité se fragilise, que chacun cultive principalement son jardin. Il est vrai que la configuration a changé. Beaucoup d’organismes LGBTQ+ sont aujourd’hui des organismes de service plus que de lobby. Ils remplissent une mission essentielle avec professionnalisme et efficacité. Mais la réflexion politique, la mobilisation collective, semblent avoir été reléguées au second plan. Le Conseil québécois LGBTQ+ qui a pris le relai de la Table de concertation des Lesbiennes et des gais du Québec n’est plus la voix militante qu’elle a déjà été ; il est devenu un relais institutionnel des organismes. Je ne dis pas que c’est bien ou mal, mais ce glissement laisse sur le carreau une nouvelle génération de militant·e·s qui ne se reconnaissent pas nécessairement complètement dans ces structures établies. Ils et elles réclament des positions plus fermes, une solidarité plus active sur de nouveaux enjeux intersectionnels pas toujours liés aux communautés LGBTQ+. Des clivages se creusent, accentuant l’écart entre «institutionnalisés» et «radicaux».
La Fierté 2025 aura au moins eu ce mérite : de rebattre les cartes. Mais encore faut-il savoir quoi en faire. L’erreur serait de laisser la poussière retomber pour mieux la balayer sous le tapis. Pour éviter que l’histoire se répète, il faut tirer des leçons. Cela suppose d’accepter une rencontre franche entre toutes les parties : les pro-Fierté Montréal, les pro-Indomptables, le Conseil québécois LGBTQ+, les militant·e·s de terrain, les simples citoyen·ne·s, en personne pas à travers les réseaux sociaux. Sans posture défensive, sans ego surdimensionné, avec l’envie réelle de trouver une stratégie commune, surtout lorsque nous sommes appelés à nous prononcer sur des enjeux dépassant nos réalités immédiates. Car répéter « So ! So ! So ! Solidarité ! » dans la rue n’aura jamais le même poids que d’incarner concrètement ce mot. Sans doute qu’un·e médiateur·ice serait nécessaire pour convoquer ce grand bilan. Un espace où se rencontreraient les représentant·e·s d’organismes, des chercheur·euse·s, des élu·e·s, mais aussi des citoyen·ne·s LGBTQ+ ordinaires. Ce serait une occasion unique de redonner ses lettres de noblesse au mot « solidarité », trop souvent galvaudé. Car au fond, le moment est venu. Non pas de choisir un camp, ni de rejouer sans fin la même querelle, mais de réfléchir ensemble à ce que nous voulons bâtir. Si la Fierté 2025 a révélé une chose, c’est que nos communautés ne peuvent plus avancer en ordre dispersé. L’avenir de nos luttes dépendra de notre capacité à transformer ce chaos en tremplin.